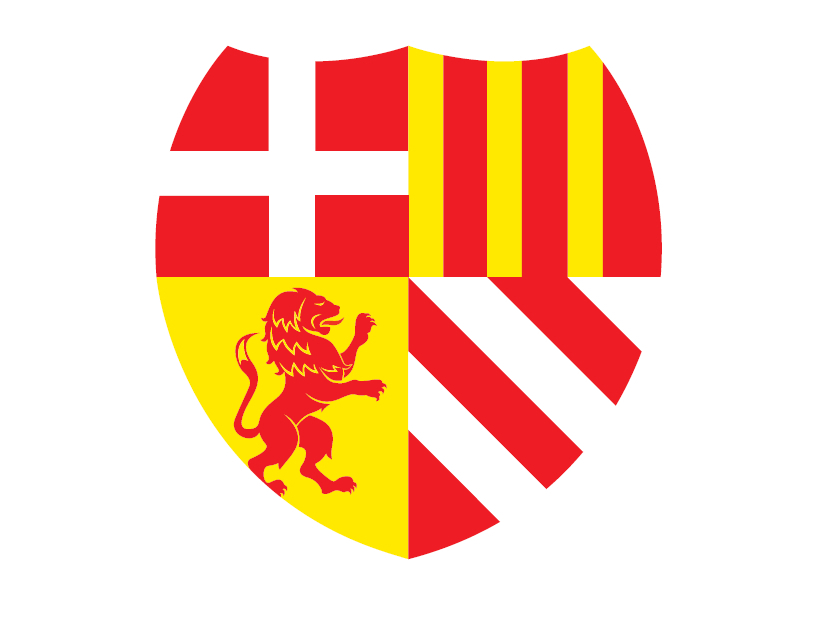La toponymie relève de l’étude des noms de lieu. Le but est de rechercher leur signification et leur origine ainsi que leurs modifications au cours des âges. L’amalgame des peuples et donc la superposition des langages dans une même région font que ces noms ont subi des transformations et des déformations qui rendent délicates ces recherches. Les philologues ont pu, dans un grand nombre de cas, donner l’étymologie et le sens de ces toponymes qui fournissent des lumières précieuses sur les étapes de l’occupation du sol. Comme nous le rappelle Paul Guichonnet , « les enseignements de la toponymie demeurent souvent à l’état d’hypothèses et tous les noms de lieux ne peuvent être élucidés mais, malgré leur caractère conjectural, et sans leur prêter une importance absolue, ils sont, jusqu’au seuil de la période contemporaine, les seules indications dont nous disposions, bien souvent ».
Quelle plus belle interprétation de l’origine du mot Voirons, cette montagne qui porte notre village que la suivante. Du haut de ce perchoir, on peut remarquer que notre montagne fait un angle. En partant du côté de St-Cergues pour se rendre à l’autre bout sur les communes de Bonne-Fillinges, les chemins de la crête dessinent un grand arc de cercle. Depuis cette crête, on peut s’arrêter souvent contempler cette vue à 360° sur le Chablais, le Genevois, le Faucigny. Cet effet panoramique, cette capacité offerte de « voir-rond » aura donner de belles idées à certaines. Sottise pour touriste diront certains. Beaucoup plus prosaïquement, il faut comme souvent, retrouver l’origine chez les anciens, dans leur patois que deux siècles d’impérialisme culturel et social ont pratiquement éliminé. Une approche plus sérieuse dira que les mots patois Ewoeron ou Ewèrô ont une origine celtique ou germanique. La racine Eva qui se retrouve également dans le nom d’Évian indiquerait la présence d’eau sur un site montagneux. Et il est vrai que la constitution géologique d’Ewoeron en fait une véritable montagne d’eau, un réservoir qui alimentait d’ailleurs Genève par un aqueduc durant l’époque romaine.
On a attribué aux Burgondes la paternité d’un grand nombre de lieux savoyards, spécialement ceux qui se terminent par inge, déformation du germanique ingos. Cette origine est combattue par E. Muret pour l’attribuer à un nom d’homme gallo-romain en anus puis icus. Ainsi, Lucinges viendrait de Lucianus, Fillinges de Filianus (Filenio en 1012). Ch. Marteaux pense qu’à l’origine, c’était une villa Lucianicum, fondée par Lucianus. Paul Aebisher voit une origine mixte des burgondes latinisés, d’autres pensent à des racines celtiques encore plus anciennes.
La forme la plus antique du nom de notre village, attestée en 1015 sur la carte de St-Hugues est Luciniangum. Plus tard Lucingium et Lucinju au 13ème siècle. G.R. Wipf propose une autre hypothèse. Il pourrait aussi s’agir d’un domaine burgonde (ingen) au lieu dit Lug/Los, l’un des innombrables lieux consacrés à Lug, dieu celte, d’où Los-Ingen. Certainement issu d’une racine gallo-romaine, ces toponymes ont probablement connu l’influence germanique que l’on retrouve dans la terminologie inge. Ces noms sont d’ailleurs courants dans la région : Alinge, Arculinge, Boisinge, Boringe, Cursinge, Fillinge, Larringe, Matringe, Mesinge, Taninge, Paconinge, Polinge, Puplinge, Presinge, Sillinge, etc.…
Une autre version, certainement plus fantaisiste, attribue à Lucinges les racines latine « Lux » (la lumière) qui aurait pour origine l’exposition privilégiée du village au soleil.
Ce qu’il y a de certain, c’est que depuis le 11ème siècle, le nom de lieu Lucinge s’écrit sans le « s » final, comme une nom de famille actuel. On le trouve affublé de « s » d’abord à la révolution, puis, couramment, dans les actes municipaux dès décembre 1862. Certains diront qu’il s’agit là d’une aberration et qu’il faut rétablir l’orthographe originale, celle qui correspond à l’héritage historique millénaire de notre commune. Mais ce « s » nous rappelle aussi que l’histoire est en marche et que les noms ne cessent d’évoluer.
Le Moyen-Age est marqué par une reprise de l’action humaine sur la nature, liée à l’augmentation de la population.
Les grands domaines se morcellent. Les laboureurs libres et les tenanciers et leurs familles s’établissent dans des clairières de défrichement, en dehors des villages. De petites cabanes (casae) se transforment en maisons qui à leurs tours se multiplient.
Ces fermes prirent le nom de la famille propriétaire auquel on rajouta la préposition Chez (soit la maison, la case de …) pour au fil du donner un nom aux hameaux en plein essor.
Il est d’ailleurs curieux de remarquer que ce type de toponymes est largement répandu le long d’une bande géographique traversant la France moyenne, de la Savoie au Poitou et la Vendée accolées à l’Atlantique.
Par ailleurs, ces noms caractéristiques sont rares en plaine comme le note Guichonnet qui remarque qu’ils font défaut dans le terroir d’Arthaz où l’occupation humaine a été précoce et intense.
Ces propriétés rurales sont fréquentes à Lucinges où elles représentent environ le tiers des lieux-dits.
Chez Blondet
Diminutif dérivé de blond. Origine germanique d’après Marteaux.
Chez Degradaz
Peut être du fait que la maison est installée sur un degré, un replat avant le village (hypothétique).
Chez Laphin
Famille habitant à l’extrémité de la commune ou à l’époque de la paroisse. L’orthographe est fantaisiste. Dans d’autres communes, elle est plus normale : La Fin à Bonne.
Chez Pallud
Les premiers habitants du lieu ont dû tirer leur nom de la proximité des marais, zone palustre à cheval sur Cranves-Sales et Lucinges (Pallu = petit marais).
Chez Piulet
Plusieurs hypothèses sont retenues. Premièrement : le nom viendrait de poulä caractérisant une hache. Le lieu aurait pu être habité par un bûcheron ou par un forgeron fournissant des haches de bonne qualité. Deuxièmement : pioula, piulà = personne qui se plaint toujours, qui piaille. Le lieu servait alors de refuge à une personne plaintive ou ayant une voie caractéristique. Troisièmement, le mot « piulet » dénommait à une certaine époque les personnes d’origine italienne. Cette origine rejoint la précédente pour parler d’un individu au langage différent, plus énergique, plus volumineux peut être.
Chez Robé
D’un homme dénommé Robert (en patois, robé).
Chez les Rossets
De roux. En patois, rosset = roux jaunâtre, roussâtre. Le nom peut désigner des personnes rousses ou également un bois ou des broussailles sur sols pierreux qui rougeoient à l’automne.
Chez Velluz (ou Vellut)
Homme velu (de villutum=velu, villus=poil). En 1593, un certain Dunant dit Vellut s’établit à cet endroit. A confirmer avec les actes paroissiaux
Les Arelles
De aratella, terre labourable, dérivé de arare, labourer.
La grange Barthou
En patois savoyard, « bartou » est le nom de la punaise. En fait, il s’agit plutôt d’un petit insecte méridional de la famille des cantharides, dont c’est ici la limite nord de sa zone d’expansion. Ses élytres sont rouges, semés de points noirs ; il ressemble en cela à une coccinelle, mais en plus allongé. La grange barthou évoque peut être la présence massive de cet insecte en ce lieu. C’est en tout cas la seule hypothèse que nous possédons aujourd’hui.
Bois des Fers
Forêt en pente au sud de la pointe de Brantaz. Tout porte à croire que le terme Fer est ici une déformation résultant de la prononciation patoise de l’Essert, avec mutation ss > f.
Bois de Violland
Le nom rappelle sans doute un diminutif du patois vie, sentier, par l’intermédiaire de viol qui, en vieux français, signifie sentier. Forêt aux nombreux petits sentiers ??
La pointe de Brantaz
Avec ses 1457 m, c’est le point le plus haut de la commune de Lucinges. L’origine remonte peut être au celtique bren, forêt, taillis ou encore au bas latin branda, bruyère.
La Chandouze
Torrent au nord du village affluent du Foron de Juvigny.
Formes anciennes : 1278 Chanjousaz ; 1306 Changousaz ; 1327 Chansouzaz ; 1730 Chandouze, Chandeuse. Son origine est probablement celtique, de candosa ou candus, blanc, l’écume de l’eau donnant l’image d’un torrent plein de blancheur.
Le Céron
Nom probablement issu d’un seigneur romain.
Le Feu
La Fougère
Lieu où poussent les fougères.
Les Gets
De Get, ou Git, Gis, Gy, vieux mot qui signifie couloir. Se rapporte donc au couloir à forte pente, ravin où sont précipités les fûts, les grumes pour les faire descendre lors d’une coupe de bois en hiver. On confiait aux enfants la tâche d’y mener de l’eau qui gelait et lubrifiait ainsi ces coulées.
Les Hivernanches
Du patois hivernà pour hiverner. Lieu froid mais aussi lieu où les bêtes étaient nourries pendant l’hiver.
Une ancienne graphie étant les Vernanches, G. Künzi pense à un lieu où croissent les vernes ou sapins, du latin verna, gaulois vernos lui-même issu et dérivé du celtique guern. Il faut cependant en rester au stade de l’hypothèse. On trouve également, cités dans la littérature spécialisée des lieux-dits tels que Les Hévernées, Verninche ou Vernay.
Sous Lachat
Dauzat rattache ce mot à la racine préindo-européenne cal, indiquant la pierre, l’abri en pierre, et par extension, des pâturages d’altitude couverts d’herbages maigres. Cette racine cal ou car est à l’origine de carm ou calm ; la forme calm est passée dans le celtique puis dans le franco-provençal en évoluant en chaux.
Lachaud (La Chau)
Même origine, mauvais pré rocheux, hauteur dénudé. Mais le nom peut également venir des fours à chaux qui s’élevaient à proximité, proche d’un gisement de calcite brillante que l’on cuisait.
Motteux ou pont des Mottes
Du mot germanique mott, bas latin motta, préroman mutt, patois motta ou motha, ce terme désigne des buttes, des tertres, de petites élévations aplaties qui ont parfois servie aux seigneurs locaux de postes de défense.
Nant d’Aïre
Du patois Ayre signifiant le caractère tumultueux voir violent de ce torrent.
Les Pesses
Nom donné aux bois entourant la montée d’Armiaz. Du latin picea (pinus), le pin qui produit la poix, déformé en pëssê, pesse ou peisse en patois désignant l’épicéa en français. Ce lieu traduit la présence de ces grands arbres.
Planay
Ce toponyme peut signaler la présence de l’érable-plane aussi bien que, par le patois plâne, pléne, un petit plateau.
Le Pralère et les Pralets
A peut être pour origine le latin prataletum, réduit à pratulum, évoluant en praletum, ancien français praele pour petit pré, petite prairie, pelouse de gazon.
La Rappe (ou ruppe)
Sol en friche, plus ou moins couvert de buissons. Serait dérivé de raspa ou du patois ràpä qui désignerait une friche en pente avec des buissons. Jaccard rattache ces mots au vieux haut allemand hraspôn, gratter, raper, les râpes étant des terrains rocailleux, peu fertiles, à végétation clairsemée.
La Ravoire
Endroit, pente occupée par un bois de chênes rouvres. Parfois le bois a disparu mais le nom est resté. Une autre hypothèse, soulevée par Pégorier dès 1963 définit ravoire, ravyre comme une terre pauvre, une friche.
La Roche aux Corbeaux
Au 19ème siècle, de grands corbeaux nichaient en ce lieu.
Les Tattes
Ils désignent en vieux français des terres incultes, des sols de faible valeur agronomique se rencontrant surtout sur roches calcaires ou mollassiques. Il peut également désigner un champ improductif par le manque de culture, c’est-à-dire la friche. On dit aussi Teppes. Bossard/Chavan font remonter l’étymologie de ce terme à tippa, d’origine préromane, et qui signifie le terrain engazonné. Pour Dauzat, c’est un terme dialectal franco-provençal signifiant butte, tertre, replat, du prélatin tippa.
Les Trembles
Du patois trenblö. Lieu de croissance du peuplier Tremble (Populus tremula).
La Vignule
Evoque la présence de petites vignes. Correspond à un lieu où chaque agriculteur du haut du village possédait une micro-parcelle de vigne pour sa consommation personnelle jusqu’au début du 20ème siècle.